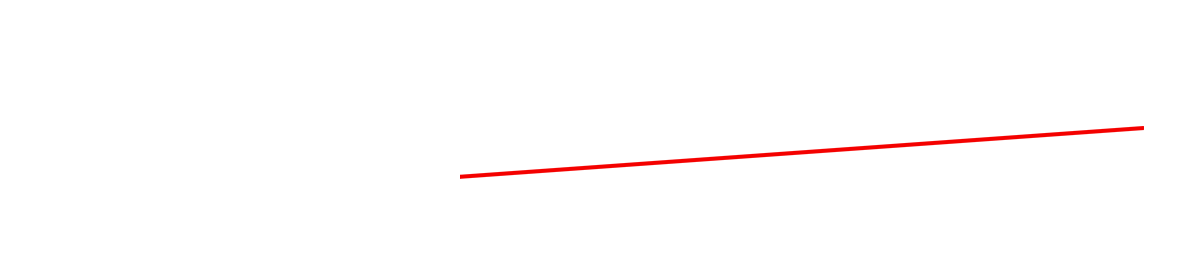Introduction aux Notes de S.B
En France, la poésie contemporaine a pratiquement déserté la pensée communiste, répartie dorénavant entre une expérimentation formelle raréfiée d’une part et une prose politique esthétisante de l’autre. La situation en Angleterre n’est probablement pas si différente, bien qu’il existe depuis longtemps une communauté active d’écrivain.e.s qui prennent au sérieux la dialectique de la poésie et du capital. Bonney écrivait à partir des vestiges de traditions qui pourraient sembler disparates — pour en nommer quelques-unes : l’anarchisme et le marxisme, le punk et la tradition noire radicale, Baudelaire, Blake, Milton, Genet et les avant-gardes du XXe siècle —, mais dont les forces se cristallisent chez lui à travers ce qu’elles ont à dire du capital, de ce que le capital fait à l’expression esthétique et de ce que cette expression esthétique aurait à offrir en refus. La poésie, pour sa part, n’est pas confondue avec la résistance, ni la résistance avec la poésie : si elle est engagée à quoi que ce soit, c’est à la compréhension des possibilités internes à sa propre forme sous contrainte capitaliste, qui pourraient inclure sa propre destruction, ou sa réalisation, dans la lutte contre la parole ennemie. Pour Bonney, la poésie, si elle a une valeur quelconque, doit refuser l’illusion qu’elle existe en dehors du « temps dominant du capitalisme ». Autrement, pas la peine d’en écrire.
Notes sur la poétique militante a été publié sur abandonedbuildings section par section au début de l’année 2012 à la suite du cycle de luttes enclenché au Royaume-Uni par le saccage de Millbank — siège du parti conservateur — mené par des étudiants en novembre 2010, qui s’est poursuivi dans un mouvement anti-austérité plus vaste dont l’acmé a été les émeutes d’août 2011 à Londres et dans tout le pays . Écrit, donc, au moment du déclin de ces luttes, dans une période de montée de l’extrême-droite et d’intensification du pouvoir conservateur. Ce contexte est crucial pour comprendre ces Notes et, plus généralement, les tournants du travail poétique de Bonney à la suite de ces évènements. Les Notes ont souvent été lues à haute voix sur des piquets de grève et pendant des occupations, et devraient être comprises comme telles.
Bonney distingue la poétique militante d’une poésie « radicale », « politique », ou « de protestation ». Poétique militante en ce que sa radicalité n’est pas seulement formelle, et non pas poésie de protestation, car consciente de ses limites : « Je trouve vraiment bizarre qu’on se plaigne le plus souvent que la poésie militante n’ait aucune efficacité, et donc que ça ne sert à rien d’en écrire. J’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui aurait écrit un poème et qui se serait attendu à ce que le poème seul change quoi que ce soit. Ce qu’il y a d’intéressant, ce n’est pas de se demander si oui ou non la poésie peut contribuer au changement, mais plutôt ce que l’expérience de l’intensité politique et sociale fait à la poésie. Mon écriture a changé après avoir été à Millbank. Elle a d’autant plus changé après que je suis sorti dans la rue pendant les émeutes. Espérons qu’elle change de nouveau. Enfin, elle a intérêt. »
Le travail de Bonney a bien changé. Il s’est mis à écrire presqu’exclusivement en prose ou en formes épistolaires, comme si le vers n’était plus capable de prendre la mesure de l’austérité du moment. Ces Notes, dans leur forme comme dans leur contenu, portent ce changement. Si la « vie du conservatisme se déroule dans un silence qui reste bien plus intense que notre langage » et que le langage disponible est lui-même déjà sous l’emprise du capital, alors une poétique militante devrait d’abord se dépouiller de la logique répressive de la poésie officielle, qui ne se distingue de la poésie bien-trop-réelle du capital qu’en apparence. Le poète, alors, s’assoit « au milieu de toute cette merde, et aboie ».
1/3
Il y a une zone de non-être, une région extraordinairement stérile et aride, une rampe essentiellement dépouillée, d’où un authentique surgissement peut prendre naissance… [une] descente aux véritables Enfers.
Fanon
Leur contenu de vérité même devient négatif. [Les poèmes] imitent un langage en-deçà de celui — impuissant — des hommes : langage de ce qui est mort dans les pierres et dans les étoiles.
Adorno
Les situationnistes nommaient poésie « l’anti-matière de la société de consommation », affirmation passablement contestable, mais qui, au moins, exprime le fossé existant entre les définitions officielles de la poésie et celles de l’avant-garde révolutionnaire, ou plutôt ce qu’il en reste. La poésie « mainstream » est insignifiante : les situs savaient que la vraie poésie du capital était publicitaire. La publicité, avant-garde entrepreneuriale, est l’anti-matière du quotidien. La poésie, parallèlement, est devenue totalement invisible — ou plutôt n’existe que dans des états étranges de haute et nécessaire intensité, dans des zones de négation absolue. Et il en resterait ainsi s’il n’était pas vrai que la publicité elle-même se perfectionne dans ce qui a toujours été la spécialité ésotérique de la poésie, c’est-à-dire le langage des morts. Les panneaux d’affichage vides, de plus en plus répandus dans l’Est londonien (et partout ailleurs), expriment avec plus d’éloquence que ne le ferait n’importe quelle poésie l’effondrement du capital dans les zones stériles et arides qu’il a lui-même créées. La publicité, ainsi que l’utopie qu’elle exprime, est désormais sa propre anti-matière. Bref, peut-être devrions nous la boucler au sujet des situationnistes — comme le dit le dicton, OUBLIE MAI 68, LUTTE MAINTENANT. Néanmoins, il est clair que la publicité, comme la poésie, tire son origine de la malédiction, du sortilège et de l’envoûtement. Les prétendus envoûtements des bardes gallois, toutes ces combinaisons secrètes de mots qui avaient le pouvoir de tuer des rois : toutes ces fantaisies sont devenues trop réelles dans leur métamorphose en combinaison de mots qui ont le pouvoir de vous faire vouloir tuer les pauvres. Et alors que tout le merdier s’enflamme, seul un idiot manquerait de voir que les envoûtements de la poésie publicitaire et leur contenu de vérité sont les sentences prononcées par des juges. La publicité n’a toujours été que le glamour moulé sur la vraie poésie du capital, les réalités arides de la peine de prison et les balles de la police.
2/3
J’ai fait taire toute émotion ; appris à me voir moi-même en perspective : dans une relation vraie avec les autres hommes et avec le monde ; j’ai élargi ma vision des choses pour être capable de penser en fonction de la totalité : pas seulement en fonction de moi-même, des miens, de mes voisins, mais en fonction du monde. J’ai renoncé à penser de manière théorique, à m’en remettre à des arguments religieux, surnaturels — toutes choses superficielles et inutiles qui ferment l’esprit et font obstacle à la pensée.
George Jackson
Ceci, tiré de la première lettre des Frères de Soledad de George Jackson, pourrait être interprété comme l’expression négative des célèbres affirmations dans les lettres de Rimbaud de mai 1871. Là où Rimbaud proposait un élargissement de la vision, dont la négation de la conscience privatisée permettrait l’entrée dans un collectif transformateur qui défierait et finalement briserait les possibilités restreintes de la conscience-as-usual bourgeoise, l’élargissement de la conscience de Jackson est rendu nécessaire et possible par un renforcement maximal de ces mêmes restrictions. Jackson écrit depuis l’isolement carcéral, où l’anéantissement presque total de sa subjectivité impose un élargissement de sa « vision » de sorte qu’elle inclut « non seulement » lui-même, « la famille » et « le voisinage » dont il est séparé (c’est-à-dire le contenu d’une mémoire qui lui est refusée), mais également « le monde », un « monde » que Jackson croit pouvoir voir avec une absolue clarté, car à travers sa séparation forcée avec le monde il est capable de rejeter les « choses inutiles » qui le définissent et l’enferment. Alors que Rimbaud croit qu’il peut atteindre la clarté par une fuite hors des contraintes bourgeoises, Jackson est contraint à cette clarté par l’impossibilité même de cette fuite. Mais plus que Rimbaud, les premières lettres de Jackson ressemblent à celles du psychopathe révolutionnaire Sergueï Netchaïev, dont le Catéchisme du révolutionnaire a été réédité par les Black Panthers en 1969 :
Le révolutionnaire est un homme condamné d’avance : il n’a ni intérêts personnels, ni affaires, ni sentiments, ni attachements, ni propriété, ni même de nom. Tout en lui est absorbé par un seul intérêt, une seule pensée, une seule passion — la Révolution… Au fond de lui-même, non seulement en paroles, mais en pratique, il a rompu tout lien avec l’ordre public et avec le monde civilisé, avec toute loi, toute convention et condition acceptée, ainsi qu’avec toute moralité. En ce qui concerne ce monde civilisé, il en est un ennemi implacable, et s’il continue à y vivre, ce n’est qu’afin de le détruire plus complètement.
Là où Rimbaud désire aussi se libérer de « toute loi, toute convention et toute moralité » de l’ordre civil bourgeois, Netchaïev refuse l’extase de cette libération et s’ancre lui-même au cœur cruel de ce même ordre. En cherchant à exprimer à travers sa personne la négation absolue de la réalité quotidienne, Netchaïev devient la personnification de sa trivialité et de sa brutalité et de sa banalité de base. La « passion » pour « la Révolution » dans laquelle Netchaïev doit éradiquer son être n’est que l’expression négative de la « passion » pour l’argent à laquelle tout bourgeois sacrifiera extatiquement sa personne. Jackson est contraint à une position plus radicale que Rimbaud ou Netchaïev précisément à cause de l’éradication forcée de cette passion. Jean Genet, dans son introduction au livre de Jackson, affirme que la zone aride à laquelle donne accès ce refus nécessaire (vital) de la passion est le lieu d’où peut émerger une nouvelle poétique militante. Genet parle ainsi des écrits de Jackson, et de ceux d’autres militants noirs emprisonnés :
Leurs voix sont de plus en plus nues, de plus en plus noires, de plus en plus accusatrices, implacables, arrachant d’elles toutes références aux cyniques escamotages de l’entreprise et de l’emprise religieuses. Elles sont de plus en plus singulières, et singulière aussi cette façon qu’elles ont toutes d’opérer un mouvement de conversion pour dénoncer la malédiction non d’être Noirs, mais captifs.
Genet insiste pour que les lettres de Jackson soient lues comme de la « poésie » : son utilisation du mot, comme celle des situationnistes, est symptomatique d’une crise de cette forme d’art — crise qui s’exprime le plus vivement dans le fait qu’elle reste une forme d’art —, due en partie à l’échec du surréalisme dans sa tentative hautement publicisée de synthèse de Marx et de Rimbaud. C’est une compréhension des possibilités de la poésie qui semble aujourd’hui presque désespérément utopique. Les écrits de Genet, des situationnistes et de Jackson, en dépit des degrés de rage et de violence glaciale que chacun d’eux ont atteints, sont imprégnés d’optimisme révolutionnaire. La victoire, selon tous ces auteurs, était inévitable. Depuis la perspective de notre propre apocalypse, un tel optimisme se lit, au mieux, avec amertume. Mais peut-être qu’une amertume glaciale est exactement ce qu’il nous faut. L’austérité violente de l’écriture de Jackson, comme celle des déclarations de Genet à son sujet, ont peut-être réussi à introduire clandestinement une partie de cette charge révolutionnaire dans notre propre situation historique. L’austérité du langage implique que tout doit être mis à nu. Genet note que pour que ses lettres échappent à la censure de la prison, Jackson doit dissimuler toute sa passion dans un langage où la seule émotion permise est la haine. La poésie, « les mots calomniés, réprouvés… les mots qui n’appartiennent pas au vocabulaire », devient autant de contrebandes. Contraint de parler la langue du geôlier, le captif n’est autorisé à parler que d’une manière qui soit absolument compréhensible par ce geôlier. Toutes ces nombreuses choses que le mot « poésie » est censé signifier commencent à se déformer et à se désagréger sous une telle pression. Ailleurs, Genet parle avec dédain du poème et de l’œuvre d’art bien faits : « plus une œuvre est proche de la perfection, plus elle se renferme sur elle-même ». Cet enclos esthétique est, manifestement, la contre-prison. L’ésotérisme réactionnaire des remarques d’un George Steiner, affirmant que « les poèmes de Celan nous emmènent au-delà de ce que nous savons déjà », ou d’un Mario Vargas Llosa, pour qui « nous restons dans le noir, incapables de pénétrer cette mystérieuse auréole que nous sentons être le secret de l’originalité et de la puissance de la poésie [de César Vallejo] », occultent la souffrance sociale, la faim et la rage contenues dans leur poésie. Quiconque ayant subi l’humiliation immonde d’être exclu de la « perfection » de la réalité bourgeoise ne sait que trop bien ce qu’est cet « au-delà », ce qu’est ce « secret », et il le sait parce que c’est lui. Méprisant une poétique qui n’est jamais qu’une parodie esthétique de la forme-marchandise, Genet laisse entendre qu’il faut penser les termes d’une poésie qui puisse être en quelque sorte antérieure à elle-même, et donc forcer ce « secret » à la lumière crue du jour.
2,5/3
Là-bas aussi, il y a des carrefours sur lesquels des signaux lugubres éclatent comme des éclairs dans la circulation, où les analogies et les imbrications d’événements, impensables les unes comme les autres, sont monnaie courante. C’est l’espace dont rend compte la poésie du surréalisme. Et il faut le relever, ne serait-ce que pour faire face au malentendu de rigueur, celui de l’art pour l’art. Car l’art pour l’art, ça n’a presque jamais été à prendre au pied de la lettre, ça a presque toujours été un pavillon sous lequel vogue une cargaison que l’on ne peut pas déclarer faute d’en avoir encore le nom. Ce serait le moment de se mettre au travail sur une œuvre qui, plus qu’aucune autre, éclairerait la crise de l’art dont nous sommes témoins : une histoire de la poésie ésotérique.
Walter Benjamin croyait que la poésie la plus hermétique avait un contenu latent, un secret qui, en étant réellement prononcé, pourrait nier le secret de la marchandise. Il a fait une analogie convaincante entre Rimbaud, Lautréamont, Dostoïevski, et les « machines infernales » des terroristes anarchistes du XIXe siècle. Mallarmé en a fait de même. Cela ne fonctionne pas vraiment : le nihilisme de Netchaïev, ou l’anarchisme de Bakounine, sont pour le moins équivoques. Le contenu de la fuite de Rimbaud hors de la poésie — c’est-à-dire la réalisation de cette poésie — était une fuite dans le silence du colonialisme, du libre-échange et du vampirisme capitaliste. Si la poésie ésotérique est potentiellement l’expression tacite de la destruction du capitalisme, elle est toute aussi potentiellement l’expression tacite du fascisme qui se cache toujours au cœur du capital. Ainsi, l’insistance d’André Breton sur la nécessité d’élaborer une combinaison des visions de Rimbaud et de Marx reste l’une des idées les plus importantes de l’histoire de la poétique moderniste. Elle a encore à être réalisée de manière satisfaisante. La fétichisation de la poésie par Breton l’empêche de comprendre que son contenu latent ne peut se réaliser qu’à travers une dialectique entre poésie et marxisme, et non par la simple relation de complémentarité qu’il envisageait. Que cette dialectique risquait la destruction de la poésie comme poésie était trop pour ce que Breton pouvait supporter. De même, la réalisation situationniste de la poésie, comme détournement de la réalisation marxiste de la philosophie, a été une occasion cruciale, opportunité que nous avons jusqu’ici manquée. C’est à cause de cet échec que les essais politiques que Jean Genet a écrits entre la fin des années 60 et sa mort au début des années 80, et en particulier la suite de textes sur George Jackson, sont peut-être les essais sur la poétique militante les plus évocateurs et les plus importants pour notre époque. Ils n’ont pas encore été suffisamment compris. Genet, pas idéaliste, connaissait l’ambiguïté fondamentale du modernisme extrémiste plus que quiconque depuis Benjamin. La dialectique de la poésie radicale impliquait aussi qu’elle soit réalisée dans la brutalité du capital lui-même. Le cycle de George Jackson établit une lutte à mort entre les sentences prononcées par le juge et les phrases que Jackson a écrites à l’isolement. La prosodie de la domination du capital est inséparable de chaque syllabe prononcée par le juge. Sa sentence gèle le temps du captif qui doit maintenant vivre à l’intérieur de cette sentence pendant des mois, des années, une vie entière. Dans la mesure où cette vie est presque effacée, la sentence du juge remonte également dans le temps, prenant possession de chaque seconde vécue par le captif. Genet veut croire que chaque phrase que Jackson écrit, depuis l’intérieur de son invisibilité imposée, nie la prosodie du juge : pour Genet, l’écriture de Jackson réalise un contre-temps qui est nécessairement révolutionnaire. Ça n’a d’idéaliste que l’apparence. Pour lui, l’écriture révolutionnaire de Jackson peut, sans dénigrer son militantisme ni d’ailleurs sa poésie, être qualifiée de « poétique », et ce seulement dans le contexte de l’affirmation blakkienne qu’il propose et selon laquelle « l’entreprise révolutionnaire d’un homme ou d’un peuple a sa source en leur génie poétique, ou, plus justement, cette entreprise est la conclusion inévitable du génie poétique ». Ce qui est à double tranchant : si c’est vrai, alors le juge est la conclusion du génie poétique de la bourgeoisie. Les différents niveaux sur lesquels la lutte des classes doit être menée comprennent une poétique réalisée. Pour Jackson, le « génie poétique » du peuple afro-américain n’a toujours été que « la théorie selon laquelle nous ne servons à rien sinon à servir ou à divertir nos geôliers » :
L’amour n’a jamais détourné la botte, le couteau ou la balle ; il n’a jamais satisfait la faim de mon corps ou de mon esprit. Le responsable de ma faim, l’auteur des pressions extérieures qui ont été l’unique cause de mes maux, ne trouvera pas la paix, ni dans cette vie, ni dans l’autre, ni dans celle qui la suivra ; jamais, jamais. « I’ll dog his trail to infinity », indéfiniment. Aimer ce qui me cause cette souffrance insupportable ? Jamais !
Le Hellhound on my trail de l’ancienne mythologie du blues, guère utile à Jackson, est renversé. Le langage de Jackson est ce qui reste après l’arrêt du disque. L’élan de la poétique traditionnelle s’est métamorphosé à l’intérieur de la cellule, où règne une forte compression temporelle, en une clarté nerveuse, contenu pur qui, à son tour, se transforme en intention :
L’un de ces grands dispositifs électriques ultra-lumineux, utilisé pour éclairer les murs et les alentours la nuit, projette un faisceau de lumière directement dans ma cellule (j’ai déménagé dans une autre cellule la semaine dernière). Par conséquent, j’ai assez de lumière, même après l’extinction habituelle des feux sur les coups de minuit, pour lire ou étudier. Désormais, je n’ai pas vraiment besoin de dormir si je ne le veux pas. Les premières heures du matin sont le seul moment de la journée où l’on peut trouver un répit dans ce pandémonium engendré par les plus incultes des détenus de San Quentin. Je ne laisse pas le vacarme me déranger, même le soir quand il atteint une intensité exaspérante, parce que j’essaie de saisir ce qui m’entoure.
2.9/3
George Jackson s’efforce de saisir le contenu de vérité de son invisibilité — la cellule comme molécule déterminante du monde officiel, qui, pour citer Marcuse citant Hegel, est « un monde étranger soumis à des lois inexorables, un monde “mort” lésant la vie humaine ». Ou plutôt, un monde mort dans lequel Jackson a soudainement pris vie, et doit maintenant sonder ce qui est compréhensible et vivant dans son vacarme et son intensité ahurissante. De sa cellule de San Quentin, Jackson écrit depuis le cœur d’une position que n’a fait qu’effleurer la poésie occidentale à ses plus grandes heures, et ce n’est qu’en en ayant conscience que nous pouvons commencer à comprendre ce que Genet semble dire, lorsqu’il insiste sur sa perception de l’écriture de Jackson comme poésie. Il est révélateur que Jackson parle de l’univers carcéral comme Pandémonium, car Milton évoque la même situation insupportable. Quand, dans le dixième livre du Paradis perdu, Satan et le reste des citoyens de Pandémonium sont métamorphosés en serpents, cette métamorphose se traduit principalement par la perte du langage, de la communication et de la pensée : « Terrible fut le bruit/du sifflement dans la salle remplie d’une épaisse fourmilière de monstres compliqués » — les anges rebelles sont entraînés dans un vacarme d’une « intensité exaspérante », là où parole et pensée sont devenues impossibles. Les tentatives de surmonter les nécessités de la parole et de la cognition depuis le lieu de leur impossibilité est un thème déterminant dans toute la poétique révolutionnaire, de Milton à Blake et Shelley, en passant par Marx et par les avant-gardes radicales du début du XXe. L’Urizen de Blake, dans Les quatre Zoas, essaie sans succès de communiquer avec les « formes horribles et les visions de tourment » qu’il voit à l’intérieur de l’Abysse — la prison, l’usine, le bidonville —, car son langage, qu’il soit « apaisant » ou « féroce », n’est qu’« un grondement indistinct ». La poésie de Shelley est riche du sentiment d’un langage libéré, venant d’un lieu si éloigné du monde officiel qu’il peut à peine être entendu, s’il l’est : dans La révolte de l’Islam, l’esprit de la Liberté s’exprime dans « un langage dont l’étrange mélodie/pourrait ne pas appartenir à la terre », tandis que dans Prométhée délivré, nous dit-on, nous ne pouvons parler si nous ne parlons pas déjà « le langage des morts ». Ce langage des morts n’est autre, en termes marxistes, que la voix du travail mort, le capital lui-même. Une grande partie de la poésie contemporaine, aussi bien « avant-gardiste » que « mainstream », est allergique à ces voix, et aimerait prétendre que le temps poétique vit séparément du temps dominant du capitalisme. Ce n’est pas vrai. La poésie doit prétendre ne pas pouvoir communiquer des « idées », car la cargaison qu’elle transporte — pour reprendre la métaphore de Benjamin — est la voix collective des victimes de ces idées. Les exercices soigneusement assemblés qui se font passer pour des poèmes ne peuvent jamais être que d’élégants fac-similés des dehors de cellules comme celle de George Jackson, mais ce ne sont que les défauts et les fissures, à leur surface, qui parlent véritablement. Alors que sa propre poésie commençait à se fissurer sous la pression des contradictions de plus en plus évidentes entre ses engagements esthétiques et politiques, LeRoi Jones (Amiri Baraka) écrivit, en 1964, que « la poésie se destine à des sens complexes. Des sens non encore pourvus ». La poésie ne parle pas du monde, ni ne crée de sens, mais se destine plutôt à des sens non encore articulés, des sens non pourvus dans les réseaux esthétiques et sociaux actuellement disponibles. Ce qui pousse la poésie à une condition-limite critique qui risque de la détruire en tant que poésie d’une manière bien plus sérieuse que n’importe quel stupide nihilisme entrepreneurial prétendant avoir « tué » la « poésie ». Des sens qui, exprimés, risquent de mettre le poème en pièces. Édouard Glissant décrit ce même processus, soustrait à la charpente de l’histoire de la poésie pour entrer dans le temps réellement vécu :
Puisqu’il est interdit de parler, on camouflera la parole sous la provocation paroxystique du cri. Nul n’irait traduire que ce cri si évident puisse signifier. On n’y supposera que l’appel de la bête. C’est ainsi que l’homme dépossédé organisera sa parole en la tramant dans l’apparent insignifié du bruit extrême.
L’organisation de la parole provoque une propagation de significations qui était, auparavant, impossible : il va sans dire que cette organisation n’a pas encore été atteinte. La poétique de l’ennemi n’a pas cessé d’être victorieuse, son propre « apparent insignifié » de « bruit extrême » n’est que trop facilement compréhensible. Le 21 août 1971, trois jours avant l’ouverture prévue de son procès, George Jackson a été abattu par un gardien de prison. Si le secret interne de la poétique bourgeoise est la voix des opprimés et des dépossédés, son périmètre de musellement est la balle du flic.
3/3
Quant à la pensée politique des Black Panthers, je suis convaincu qu’elle trouve son origine dans la pensée poétique des Noirs américains… Nous nous rendons compte de plus en plus qu’une émotion poétique est à l’origine de la pensée révolutionnaire.
Genet
Cet antagoniste garde encore son terrible incognito, et il réside comme un prétendant nécessiteux dans ces sous-sols de la société officielle, dans ces catacombes où, au milieu de la mort et de la décomposition, germe et bourgeonne la vie nouvelle.
Heine
J’entendis chanter des chansons qui semblaient avoir été composées en enfer, et dont les refrains témoignaient d’une fureur, d’une exaspération qui faisaient frémir. Non, dans notre sphère délicate on ne peut se faire aucune idée du ton démoniaque qui domine dans ces couplets horribles ; il faut les avoir entendus de ses propres oreilles, surtout dans ces immenses usines où l’on travaille les métaux, et où, pendant leurs chants, ces figures d’hommes demi-nus et sombres battent la mesure avec leurs grands marteaux de fer sur l’enclume cyclopéenne.
Heine
Par conséquent, il n’y aurait pas à transférer l’image dialectique dans la conscience à titre de rêve, c’est au contraire le rêve qu’il faudrait extérioriser à travers la construction dialectique, et l’immanence de la conscience elle-même serait à comprendre comme une constellation du réel. Pour ainsi dire comme la phase astronomique pendant laquelle l’enfer traverse l’humanité. Seule la carte stellaire d’une telle pérégrination pourrait, me semble-t-il, dégager la vue sur l’histoire comme histoire primitive.
Adorno
Le noyau révolutionnaire du fétiche-poésie devient clair si les lettres de George Jackson sont lues à côté de Lautréamont. Dans un essai de 1943 sur Lautréamont, Aimé Césaire écrit : « Par l’image on va à l’infini ». Cet « infini » n’est pas une échappatoire bourgeoise à travers laquelle l’amateur de poésie peut atteindre une résidence sécurisée d’harmonie cosmique : lorsque Lautréamont moque sa plume, qui a rendu « mystérieuse » une ennuyeuse rue parisienne comme la rue Vivienne, il veut dire que l’image poétique a été transformée en un éclat de verre figé au centre de votre œil, un verre au travers duquel nous voyons les capitalistes, en tant que classe, comme les poux et les punaises qu’ils sont véritablement, et de manière similaire le prolétariat devient un essaim de fourmis rouges carnivores. Dans une prise d’assaut figurative de la Bastille — ou de Newgate, ou de San Quentin, ou de Soledad —, le contre-panoptisme de l’image poétique offre une vision radiographique de l’infraviolence de la réalité capitaliste. Le Discours sur le colonialisme de Césaire, publié en 1955, insiste sur le fait que l’œuvre de Lautréamont est une « implacable dénonciation d’une forme très précise de société ». L’« infini » est précisément cette « dénonciation » où, dans les termes d’Adorno, l’enfer traverse l’humanité. Le monde à l’envers, ou renversé. Blake, que je serais désormais tenté d’appeler le Lautréamont anglais, a poursuivi une semblable activation de la perception :
Alors je déverserai sur eux ma fureur, et renverserai
La précieuse bénédiction ; sur leurs couleurs de beauté
J’apporterai de la noirceur ; aux bijoux un givre craquelé ; à l’ornement de la difformité ;
Sur leurs couronnes, des serpents enrubannés ; aux parfums, une corruptibilité puante ;
Aux voix de félicité, de rauques coassements désarticulés par le gel ;
Au travail du soin paternel et à la douce instruction, j’apporterai
Des chaînes d’obscure ignorance et des cordes de vanité torsadée.
La « précieuse bénédiction », les « couronnes » et « parfums », qui tous sont notre droit de naissance, ont été réduits en morceaux par l’alchimie capitaliste, et nos « voix de félicité » ont été habitées par la publicité, qui ne peut être contrecarrée que par les « rauques coassements » du sortilège poétique. Mais les réalités de la cellule de prison et les balles de la police ont rendu la beauté poétique banale. La poétique capitaliste transforme la vie quotidienne en sublime de l’annonceur. Chaque panneau publicitaire abandonné est un rapport sur la nature de votre invisibilité. L’effondrement du capital a neutralisé le contre-panoptisme de la poésie : Blake devient un emblème du nationalisme anglais, Lautréamont devient un refuge pour gothiques. Et pourtant, une lecture anti-conformiste pourrait provoquer une décharge électrostatique, un bref éclat où tout ce qui demeure instable dans le poème — tout ce qui ne peut être réduit au simple fétichisme — est tout ce qui reste. Ce qui intéressait Benjamin, concernant les avant-gardes du début du XXe siècle, c’était leur mélange de « paroles, de formules magiques et de concepts ». La cinglante clarté du slogan pénètre l’ésotérisme de la formule magique, formant de nouvelles constellations de sens et un nouveau rationalisme absolument étranger aux formes bourgeoises de la logique. S’il est vrai que seule la poésie peut le faire, il est tout aussi vrai que presque aucune poésie (qu’elle soit dite mainstream ou d’avant-garde) ne le fait réellement. Quand, dans le poème « Black people », Amiri Baraka dit : « Les mots magiques sont : Contre le mur, enfoiré, c’est un braquage », il avait trouvé le point presque invisible où George Jackson et Lautréamont deviennent la même personne, où le tract révolutionnaire et le poème ésotérique deviennent une seule et même chose. Le « mur » est la limite du poème, ainsi que le lieu contesté où le poème se fond dans la réalité absolue, où « le point invisible », dans son état de crise, devient visible, et pourtant…
Ce n’est rien ! j’y suis ! j’y suis toujours.
Nous avons besoin de nouvelles formes. De nouveaux modes d’expression.